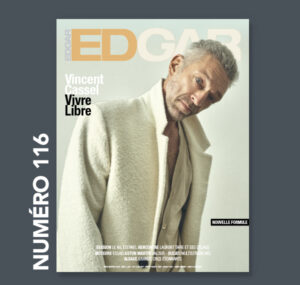Il est à l’affiche de « Par le bout du nez », sur les planches, face à François Berléand. Et à celle de « Divorce Club », nouvelle comédie attendue de Michaël Youn. Ubiquiste, grand gourmand de vie et incorrigible bon vivant, le comédien François-Xavier Demaison prend le temps, entre deux répétitions, de parler cinéma, théâtre et notoriété. Aveux d’un faux pressé.
Une pièce de théâtre avec François Berléand. Une comédie de Michaël Youn doublement primée au Festival de l’Alpes d’Huez. Vous débutez 2020 sur les chapeaux de roues…
Je ne me plains pas. François, je suis très heureux de le retrouver sur les planches treize ans après L’Arbre de joie que nous avions joué ensemble. Le texte, signé des auteurs du Prénom, est très drôle, très intelligent, et mis en scène par Bernard Murat qui connaît la chanson. Les planètes sont bien alignées cette année.
Aviez-vous envie de sortir du one-man-show ?
Clairement oui. Après 250 dates de tournée, douze Olympia et un direct sur Canal Plus, j’avais envie de changer d’air pour la saison suivante. Et la pièce est venue à point de manière très sympathique. Il y aura un quatrième spectacle, c’est certain. Je prends juste le temps de l’écrire.
Difficile de trouver les bonnes histoires, les bons scénarios ?
Je suis très verni de ce côté-là aussi. Il y a le Michaël Youn, Divorce Club, sur lequel je me suis éclaté, et aussi le nouveau film d’Audrey Dana, Hommes au bord de la crise de nerfs, que je viens de tourner dans le Vercors avec Thierry Lhermitte, Ramzy et Marina Hands ; une histoire de thérapie de groupe, de retour à la nature, qui part en vrille. Je ne suis pas en mauvaise compagnie. La scène me permet de prendre mon temps pour mieux choisir, de ne pas être forcé à toujours courir après le bon scénario. Je veux des histoires qui me parlent.
Il y a un peu plus de dix ans maintenant, vous obteniez une nomination aux Césars. Avez-vous eu le temps de vous retourner, de faire le bilan ?
Les choses évoluent dans le bon sens, je pense. J’ai pu me diversifier. J’ai repris la direction du Théâtre de L’Oeuvre, il y a maintenant cinq ans. C’est un succès. Je produis : Le Maître d’école, la série Quadras… Je suis le parrain d’un festival tout nouveau, Pelicula, dans le sud de la France, qui réunit mes passions, le cinéma, la scène et la gastronomie avec des chefs qui seront présents. Il n’y a pas que l’humour pour aller à la rencontre des gens mais bien d’autres biais. J’ai pu me déployer au fil des années sans jamais avoir l’impression de me répéter.
Insatisfait parfois ?
Toujours. C’est une forme de politesse. Je ne devrais pas dire ça mais, un one-man-show, il faut le jouer cent fois pour trouver son rythme de croisière et y prendre un plaisir absolu. Le texte devient un prétexte sur lequel on s’amuse, on en sort, on improvise… Et puis, on ne va pas se mentir, il y a de plus en plus d’humoristes. Comment trouver son originalité, son propos, son point de vue ? Je ne vais pas refaire l’histoire du mec dans la finance qui décide de changer de vie après le 11 septembre.
La concurrence est-elle forte ?
Il y a beaucoup d’humoristes qui ont dix minutes de spectacle. Tenir 1h40, c’est autre chose. Est également arrivée une jeune génération profondément influencée par les humoristes américains. Il y a le tri à faire là-dedans. Il y a beaucoup de boulards, de melons dans le lot, et des gens fabuleux comme Roman Freyssinet ou Marina Rollman que j’ai fait monter au Théâtre de L’Oeuvre d’ailleurs.
N’avez-vous jamais l’impression d’un rendez-vous manqué avec Coluche, l’histoire d’un mec en 2007 ? Un César aurait-il changé la donne pour vous ?
Disons que la sortie du film avait été entourée de polémiques avec un accueil parfois un peu compliqué. Coluche, c’était trop d’émotion, trop d’affect partagés. Rien que la démarche du film était épineuse. Il y avait une sorte d’hystérie autour du sujet. Tout le monde voulait donner son avis. Lederman nous est tombé sur la gueule, la famille a eu son mot à dire, n’importe lequel de ses copains ou son coiffeur y allaient de leur interview dans France Soir… Ça a un peu différé le rendez-vous avec le public. Il est venu sur la longueur. Le film est beaucoup plus apprécié aujourd’hui.
En 2019, la « profession » misait beaucoup sur deux comédies dans lesquelles vous apparaissiez : All Inclusive et Ni une ni deux. Elles ont subi des déconvenues sévères au box-office…
Tout est relatif. All inclusive reste quand même le cinquième meilleur film français de l’année et a cartonné lors de son passage sur Canal. Ni une ni deux, c’est un très joli long-métrage mais pas un événement. Aujourd’hui, j’ai l’impression que le public ne se déplace plus, majoritairement, que pour les événements. C’est parfois violent surtout quand vous avez le sentiment que votre film est réussi. Mais il y a eu de vrais accidents industriels l’année dernière dont, bienheureusement, je n’ai pas fait partie.
Y’a-t-il un mercato des acteurs ? Sent-on les turbulences d’un point de vue professionnel ?
C’est vrai que les distributeurs vont être tout de suite plus regardants. Vous déclenchez moins l’enthousiasme en sortant d’un bide à 50 000 entrées que d’une réussite à 2 millions. Mais la popularité ne se mesure pas uniquement au désir des distributeurs et aux chiffres au box-office. Cela ne déclenche pas d’angoisse particulière chez moi. Et la promesse d’un film comme Divorce Club est, à mes yeux, est très porteuse.
Des films que vous mettriez sous le tapis ?
Sur les cinquante que j’ai tournés ? Même pas 10 %. Avouez que c’est tout de même pas mal…
Que gagne-t-on avec les années ?
Avec le temps, j’ai fini par faire partie du paysage. Je crois que les gens m’aiment bien. Je suis présent. Un acteur apprécié vu comme un bon artisan. Il y a moins cette frénésie de suivre la courbe comme au moment où vous explosez, que vous devenez une espèce de « produit de l’année ». Je fais aujourd’hui ce métier de manière moins contestable.
Perd-on patience pour certaines choses en mûrissant ?
Je me lasse facilement de l’hystérie médiatique actuelle. Lorsque vous sortez une phrase de son contexte, que vous faites un effet de loupe dessus, vous entérinez le « lynchage de la semaine ». C’est très facile. Et personne n’en sort grandi. J’aimerais bien que les gens retrouvent un peu plus de leur libre arbitre, de leur sens critique, par rapport à certains emballements des réseaux sociaux ou journalistiques. Je n’ai jamais fait l’objet de polémiques sur mes spectacles. Je fais attention à ne pas provoquer et à toujours être compris. J’ai toujours préféré supprimer une vanne plutôt que d’avoir à faire rire aux dépends de quelqu’un. J’inspire, j’imagine, quelque chose de beaucoup plus fédérateur. Du fait de ma bonhomie peut-être…
Vos objectifs désormais ?
La gestion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je ne veux pas finir brûlé par le travail comme ces artistes qui, à 50 ans, se retrouvent seuls. Continuer à faire les bons choix. Et à créer la surprise tous les deux ans. Le rapport à l’inspiration devient plus compliqué, c’est certain, mais de très belles choses arrivent. Et puis, je veux vivre
heureux. Entre Paris et le Sud où j’ai ma maison. Avec ma jeune et charmante épouse Anaïs. Mes deux gros chiens. Mes deux chats. Je fais aussi mon propre pinard, le Mirmanda, désormais. Je tiens à garder intacte ma soif de diversité.
Photos © Stéphane de Bourgies.

Signature « historique » d’Edgar pour le cinéma, lecteur insatiable, collectionneur invétéré d’affiches de séries B et romancier sur le tard (Le Fantôme électrique, éd. Les Presses Littéraires).
Contact Twitter