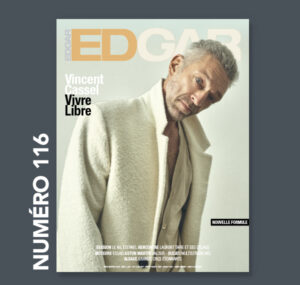Remisez au clou les chromos Elvis. Bananes, blousons et tutti Billy. Les stylisés Spunyboys pratiquent un rock aussi sincère qu’effréné, référencé et frais. Preuve d’une sagacité à propager un son féroce et irradiant, ces fringants messieurs le portent aujourd’hui au-delà des frontières de leurs Hauts-de-France natals.
La rencontre avec les Spunyboys s’est faite à l’angle d’un comptoir de la rue Saint-André, à Lille, au bar Le 1920, très Cassavetes dans l’âme, où ces musiciens dans le sang épanchent parfois leur goût pour la blonde – la bière, leurs dames étaient restées ce soir-là à la maison. Parler rock avec ces diseurs d’élite tient de la mission à risque pour tout néophyte en rythmique des États du sud de l’Amérique. Avec des envolées lyriques et un enthousiasme communicatif, ils causent, aériens, sûrs de leur glossaire : Carl Perkins, Little Richard, Johnny Horton, le jazz Nouvelle-Orléans… Ils sont trois garçons. Le taiseux Eddie à la guitare, Guillaume, plus volubile, à la batterie et Rémi au chant et à la contrebasse qu’il fait virevolter dans les lieux de concert même les plus exigus. Pourquoi parler d’eux aujourd’hui ? Musicalement, les Spunyboys ne sont pas des perdreaux de l’année. Depuis 2006, leur capacité de nuisance auditive fait le bonheur des amateurs du genre de Tokyo au Nevada. 110 concerts par an au bas mot dont le millième a été fêté, en 2019, dans la capitale des Flandres. S’ils n’ont pas l’écho des beuglants du rap, leur brio, leur incarnation comme leur professionnalisme ont fait depuis activement leur renommée. Ce serait dommage de passer outre le phénomène.
Adulés au Japon
Au moment où Edgar leur parle, les Spunyboys s’apprêtent à faire leurs valises pour l’Angleterre le temps d’un concert. Et ont appris dans la foulée le scellement d’un autre au prestigieux Élysée Montmartre. Joli temps après les désagréments de la Covid et du confinement subis par tous. À s’intéresser de près à l’essence de ces faux-méchants garçons mais vrais passionnés viscéraux d’une musique sous influence (« Pas une heure de notre vie qui ne soit pas en lien avec elle » lâche Remi sans exagération), il y a largement de quoi s’abreuver d’anecdotes. Les références aussi s’égrainent ; « retourner aux origines » disent-ils. Déjà parentales. Guillaume et Rémi ont un père musicien toujours actif dans un band apprécié des bars musicaux du Nord de la France. Eddie, lui, originaire de Dijon, s’est installé depuis 10 ans dans la région. Son père était « loulou » dans les années 80, un blouson noir en somme, à la culture rockabilly aussi pointue qu’un stilleto (le cran d’arrêt pas l’accessoire de séduction féminin). On est loin des employé(s) corporate qui le week-end se griment en agités du be-bop pour renifler leurs années cinquante vernies aux fantasmes. Les Spunyboys vivent, respirent, mangent (et boivent) rockabilly, quitte à jouer des poings contre les esprits railleurs. Au Japon, on les vénère (« Vous demandiez une cigarette, ils vous apportaient un paquet » rappelle Guillaume pour le clin d’œil) et à Las Vegas, ils sont applaudis. Juste récompense d’années de travail et de bourlingue sur la route. Mais revenons au principal : la musique de ce « tas de cheveux gras dans la soupe » d’une production musicale hexagonale actuelle larguée entre folkeuses anémiques et hoqueteux princes de la (f)rime.

Deux albums au compteur
À leurs débuts, comme gymnastique, les deux frères Spuny, Guillaume et Rémi donc, s’essayent à différents styles du jazz au rythm and blues, « même de la world music » glissent-ils en se marrant, à travers une dizaine de groupes limite morts dans l’œuf. La rencontre avec Eddie sera décisive pour se forger un nom et un rythme sous le soleil du rock. Depuis deux albums sont nés – un troisième est en route : Just a Lille Beat – et sa pochette où le trio se fait poursuivre par une tarentule géante très studios Universal de 1955 – et Moonshine, à la fois composé d’œuvres originales et de reprises (Willie Nelson, Lee Dresser…). Là se développent leurs thèmes de prédilection, un brin distanciés des effluves de roadsters ou des bagarres à la chaîne à vélo : la paternité (Get Wild for my Child, Too Young to Cry), l’alcool quand même (Honey Hides the Bottle, Don’t Ring the Bell), l’amitié aussi (Rockabilly Legacy, Moonshine) et l’amour évidemment vécu ou déçu (Another Farewell, Natural Born Lover…). La maîtrise est là, endiablée. Le rock est précis, la voix engagée. Le trio connaît ses gammes et ses instruments. Rien à redire quant à la musicalité – y compris pour l’auteur de ces lignes qui s’est longtemps entêté à voir dans le titre Viva Las Vegas une forme absolue de Ben Hur kitsch du rock ; toute une éducation à refaire. Le plaisir trouvé à l’oreille donne impérieusement envie de les voir « en vrai ». Sur scène, il se mue, total : agités, remuants, bondissants flibustiers gominés devant vous qui tapez du pied et vous trémoussez à une cadence toujours joyeusement imposée. Leur credo ? « Si tu te fais ch**r sur scène, les gens le ressentent. Forcément, il y a partage ! » Insatiables, leurs dates se multiplient. Entre le Nord, le Benelux et Paris. Au public de saisir désormais sa chance.
Pour finir, amis lecteurs, vous vous demandez tous forcément la signification de « Spunyboys ». Une nouvelle fois, une référence : un surnom donné à Rémi, le contrebassiste et chanteur, du temps du lycée. Un truc très « happy few » pour reprendre la formule de Stendhal. Qui lui-même, notons-le, n’a jamais eu guère à voir avec le rockabilly.
Photos : Sixtine Riche


Les Spunyboys seront en concert le 7 juillet à Hoeq (Hollande) au festival De Ballade, le 8 juillet à Hoogstraten (Belgique) au Chill Mill, le 9 juillet à Alfortville (94) au festival Rock’n roll en Seine, le 10 juillet à Bailleul (59) au festival En Nord Beat, le 29 octobre à L’Élysée Montmartre (Paris)…

Signature « historique » d’Edgar pour le cinéma, lecteur insatiable, collectionneur invétéré d’affiches de séries B et romancier sur le tard (Le Fantôme électrique, éd. Les Presses Littéraires).
Contact Twitter